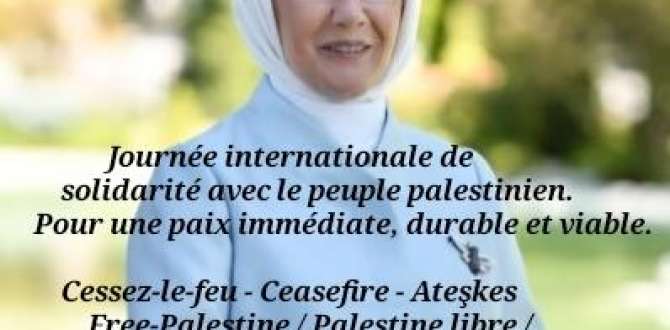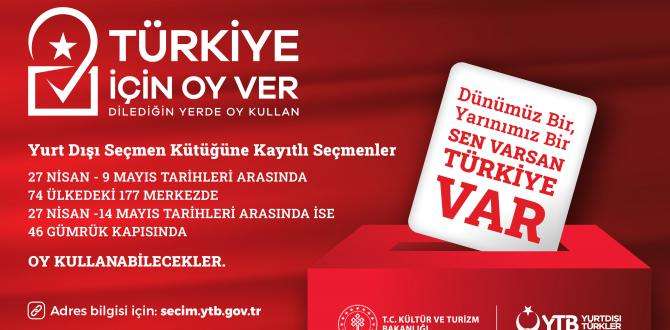LE PKK, UNE ORGANİSATİON TERRORİSTE HYBRİDE
LE PKK, UNE ORGANİSATİON TERRORİSTE HYBRİDE Fondé à la suite de ce qu’on a appelé les « années de plomb » en Europe, qui a vu la montée des mouvements politiques radicaux dans les années 1960, le PKK – « Parti des Travailleurs du Kurdistan » – est une organisation kurde qui a été créée en 1978, s’appuyant sur […]
 01 Nisan 2018 - 19:57 'de eklendi ve 2950 kez görüntülendi.
01 Nisan 2018 - 19:57 'de eklendi ve 2950 kez görüntülendi.
LE PKK, UNE ORGANİSATİON TERRORİSTE HYBRİDE
Fondé à la suite de ce qu’on a appelé les « années de plomb » en Europe, qui a vu la montée des mouvements politiques radicaux dans les années 1960, le PKK – « Parti des Travailleurs du Kurdistan » – est une organisation kurde qui a été créée en 1978, s’appuyant sur une idéologie marxiste-léniniste combiné à un nationalisme et un culte de la personnalité autour de son chef, Abdullah Öcalan.
C’est au début des années 1980 que le PKK a lancé ses actions armées contre la Turquie, exigeant d’abord l’indépendance, puis tempérant, plus tard, ces revendications séparatistes.
À la fin des années 90, la grande majorité des États occidentaux ont classé le PKK dans la liste des organisations terroristes :
-
Allemagne avait déjà désigné le PKK comme groupe terroriste en 1993.
-
Les États-Unis ont désigné le PKK comme organisation terroriste étrangère en octobre 1997 (1).
-
La Grande-Bretagne a ajouté le PKK dans sa liste noire du terrorisme en mars 2001.
-
L’Union européenne et l’OTAN ont ajouté le PKK à leurs listes de terroristes en 2002.
Ce classement ne répondait pas à une position de solidarité envers un membre de l’OTAN et un pays pro-occidental, mais comme nous allons le voir dans la suite, à la réalité des actions et de l’idéologie du PKK.
La violence armée comme mode d’expression politique :
A l’image des mouvements politiques européens d’extrême gauche des années 1960, le PKK a très rapidement utilisé la violence armée et du terrorisme comme mode d’expression et de revendication politiques, mais plus généralement comme moyen de faire régner un climat de terreur chez les populations et monopoliser la parole et l’action politique :
Massacre contre la population civile :
Allant de la punition collective contre des villages refusant de collaborer avec le PKK jusqu’aux attentats suicides, en 40 ans, l’organisation terroriste a assassiné plus de 6000 civils (2).
Au début des années 1990, le PKK a mené une campagne de punition collective, au moins 25 massacres ont été perpétrés par l’organisation terroriste contre villages protégés par des gardiens engagés par l’Etat, abattant 360 personnes, dont 39 femmes et 76 enfants. Des atrocités systématiques ont été commises dans le cadre de la « politique officielle du PKK » après 1992, que les organisations de défense des droits humains qualifient de « crimes contre l’humanité » (3).
Depuis sa fondation au début des années 1980, le PKK aura perpétré 72 500 actions terroristes en Turquie lors desquels des milliers de civils, de forces de l’ordre, des centaines d’enseignants, de médecins seront assassinés ce qui en fait une des organisations terroristes les plus brutales et criminelles au monde.
Parmi les crimes les plus caractéristiques du fanatisme et de l’identité criminelle du PKK, ceux du 25 décembre 1991 à Bakirköy – Istanbul – contre le magasin « Cetinkaya » et du 13 mars 1999, à Istanbul également, contre le centre commercial « Mavi Carsi » lors desquels des militants du PKK ont incendiés les lieux, 11 civils dans le premier attentat et 13 dans le second mourront, soit brûlés vifs, soit étouffés par l’incendie (4).
Assassinat des fonctionnaires d’Etat : enseignants, infirmiers, médecins :
C’est le 26 juin 1979 qu’eu lieu le premier assassinat d’instituteurs commis par le PKK, celui de Mehmet Saygıgüder assassiné devant ses élèves dans la cours d’école.
Parmi les exemples les plus funestes, dans la nuit du 11 septembre 1994, plus de 40 terroristes firent une descente dans la ville de Mazgirt à l’Est de la Turquie, regroupèrent 6 instituteurs présents dans leur logement et les exécutèrent, 10 autres instituteurs qui avaient trouvé refuge chez l’habitant purent échapper au massacre. (5)
En tout, de 1979 à 2018 près de 150 enseignants et instituteurs furent assassinés par le PKK pour des raisons idéologiques et xénophobes :
-
Conception marxiste-léniniste du monde auquel l’enseignement de la Turquie ne correspondait pas,
-
Enseignement en langue turque que l’organisation terroriste cible, selon son idéologie et sa terminologie, comme un outil à la solde de la « propagande impérialiste de la Turquie. »
Mais le fanatisme du PKK ne s’arrêtait pas à concevoir la langue turque comme « maléfique », durant cette période des dizaines d’infirmiers, de médecins furent assassinés.
Le PKK a également attaqué les projets économiques, tels que les travaux publics – construction de routes, immobilière – les banques, les installations médicales ont été incendiées, l’organisation terroriste a singulièrement contribué à détruire les écoles et à assassiner les enseignants.
Les citoyens de Turquie d’origine kurde travaillant dans ces projets étant particulièrement pris pour cibles.
À mesure que les capacités du PKK augmentaient, il passait de l’insurrection rurale au terrorisme urbain, allant jusqu’à employer des kamikazes. Des atrocités systématiques ont été commises dans le cadre de la « politique officielle du PKK » après 1992, que les organisations de défense des droits humains qualifient de « crimes contre l’humanité ». Au cours des trois années suivantes, au moins 768 fonctionnaires – enseignants, médecins, infirmiers, agents de sécurité – et des civils choisis au hasard sont tombées aux mains des assassins du PKK.
Elimination physique des autres groupes de gauche, leaders kurdes, ainsi que de ses propres dissidents :
Afin de s’assurer du monopole politique au sein de la communauté kurde de Turquie, le PKK a éliminé nombre de groupes rivaux d’extrême gauche tels que Devrimci Halkın Birliği – « Union Révolutionnaire du Peuple » –, Halkin Kurtuluşu – « Libération Populaire » – ou encore Devrimci Doğu Kültür Ocakları – « Foyers Révolutionnaires de la Culture Orientale » –.
A. Öcalan a non seulement éliminé d’autres groupes violents, mais aussi des partis politiques kurdes pacifiques, comme le Parti socialiste du Kurdistan – Partiya Sosyalîsta Kurdistan, PSK – de Kemal Burkay, qui sonnait la fin de l’espoir de nombreux Kurdes d’une action politique pacifique.
Il a, par ailleurs, ciblé des Kurdes accusés d’être à la « botte de la Turquie » qu’il qualifie de « traitres » ou de « fascistes ». En 1979, le PKK a atteint une notoriété nationale en assassinant Mehmet Celal Bucak, un célèbre politicien conservateur kurde et un riche propriétaire terrien dans l’Est de la Turquie. Condamné à mort par le PKK pour « exploitation de la classe paysanne », Bucak a été le premier d’une longue série de crimes politiques du PKK.
Au milieu des années 1990, affaiblit par les opérations de l’armée turque, des commandants du PKK sur le terrain savaient qu’ils avaient besoin d’une nouvelle direction, mais ils ont été empêchés d’en adopter un par Öcalan qui ne voulait pas céder de son pouvoir. Les rivaux ont été soit isolés soit tout simplement éliminés. Tout désaccord était considéré comme une tentative de saper le chef, et la déloyauté était une offense capitale.
Le PKK a assassiné des centaines de ses propres dissidents (6) préconisant des révisions de la structure ou de la doctrine autocratique. L’organisation terroriste a chassé ces hommes même lorsqu’ils ont fui en Europe. Parfois, la décision d’élimination physique ne reposait que sur des soupçons et la paranoïa d’Öcalan qui percevait les commandants populaires du PKK comme des rivaux et donc des menaces potentielles, il fit également assassiner des douzaines d’étudiants entrés au PKK à la fin des années 1980 les accusant d’ « espionnage ».
Le premier chef de l’aile européenne du PKK, Cetin Gungor (Semir), plaidant pour la démocratie interne au sein du PKK fut assassiné en Suède en novembre 1985 après avoir fui trois pays.
Comme le montre les chiffres, le PKK a, depuis sa création, très rapidement et massivement utilisé la violence armée indistinctement contre les forces de l’ordre, les civils et les représentants de l’Etat, comme mode d’expression politique.
Concernant le mode d’action du PKK, l’universitaire Mesut Hakkı Caşın, spécialiste des questions militaires affirme :
« Il y a une règle immuable au sein du PKK, celle de l’utilisation de la violence et la terreur pour intimider le peuple kurde et pour étendre à toute la Turquie l’incendie qu’il a engendré dans la région, et ainsi donner l’image et diffuser la propagande de la toute-puissance de l’organisation. » (7)
Il s’agit donc fondamentalement d’une « politique » d’occupation du terrain social et politique par la radicalité et la violence armée.
Issue de l’idéologie marxiste-léniniste qui prône la radicalité dans l’action politique et qui a une conception manichéenne du monde – riches/pauvres, occupants/damnés, bons/mauvais – la tendance du PKK aux revendications extrêmes, sa vision jusqu’au-boutiste des rapports politiques qui tend à la table rase, sa volonté de monopole par élimination des autres mouvements politiques kurdes est à double tranchant, il peut éloigner les populations, où les faire adhérer par absence d’alternative.
Cela démontre d’une part, par les faits, la radicalité et le fanatisme qui portent l’idéologie du PKK, et d’autre part, par le principe, que cette idéologie « révolutionnaire » – marxiste-léniniste –, par essence radicale, nourrit, à son tour, le PKK et d’autres organisations du même genre et engendre la violence armée en guise de ce que nous avons appelé l’ « expression politique ».
Financement du PKK par le crime organisé :
De nombreuses études ont démontré que le terrorisme et les autres formes de criminalité sont indissociablement liés. Là où les organisations terroristes prennent pied, le crime suit de manière certaine (8).
Le spécialiste des mouvements terroristes Alex Peter Schmid, de même que François Haut, juriste et directeur de recherche en criminologie à l’Université Paris II, classent les organisations telles que le PKK dans la catégorie des organisations « hybrides, semi-criminelles, semi-politiques. » (9)
« Les terroristes s’engagent dans de nombreux types de crimes, comme l’extorsion, la contrebande étrangère, la corruption, le kidnapping, le vol, la fraude documentaire, le trafic d’armes, le chantage, la cybercriminalité, la criminalité en col blanc, la contrebande, le blanchiment d’argent et, bien sûr, le trafic de drogue pour financer et faciliter activités terroristes. » (10)
Concernant le PKK, sa principale source de financement est le trafic de drogue. Plus de 80% du trafic de drogue vers les pays européens est contrôlé par le PKK. Bien qu’il soit, en raison de leur nature, difficile d’établir des estimations chiffrées, les spécialistes de la question estiment les revenus annuels de l’organisation terroriste à 1.5 milliards de dollars par an. (11)
En 2008, afin de lutter contre les revenus des organisations terroristes provenant trafic de stupéfiants, le Département d’Etat américain a classé un certain nombre d’organisations armées, dont le PKK, les FARC, ou encore Al Qaida, sous l’appellation « narcoterroristes ». (12)
En octobre 2009, le Bureau du Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) du département américain du Trésor a désigné l’un des leaders du PKK, Murat Karayilan, et des membres de haut rang Ali Riza Altun et Zubayir Aydar parmi les plus importants trafiquants de stupéfiants étrangers. (13)
Les autres sources de financement criminel, le PKK pratique l’extorsion de fonds – appelée « impôt révolutionnaire », le proxénétisme, l’immigration illégale, le trafic de main-d’œuvre, les enlèvements ou encore le trafic d’armes.
Le revenu annuel du PKK provenant de son aile européenne est estimé entre 50 millions de dollars et 100 millions de dollars. Environ un cinquième des recettes du PKK est levé de manière semi-légale, à travers un vaste réseau d’environ 400 organisations de façade, dont la moitié en Allemagne, le reste en Autriche, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Grèce, en France, Pays-Bas, Suède et Suisse.
Les sommes provenant des activités illégales sont également réinvesties dans des activités légales en Turquie et dans la plupart des pays européens, immobilier, restauration afin de pérenniser les revenus financiers.
Ainsi, le PKK possède un budget annuel variant de 1 à 3 milliards d’Euros selon les estimations pour mener sa « guerre contre la Turquie. » (14)
Guerre basée sur une stratégie qui s’appuie sur deux types d’action. En Europe de l’Ouest, le PKK se concentre sur la propagande non-violente avec des manifestations, des marches, des festivals culturels et diverses campagnes afin de présenter à l’opinion publique de ces pays une image de l’organisation « luttant pacifiquement pour les libertés », alors qu’en Turquie, l’organisation terroriste mène des actions armées contre les forces de l’ordre et les populations civiles. (15).
Organisation du PKK :
Fondé en 1978 par Abdullah Öcalan, le PKK a, au cours des années, changé à plusieurs reprises son nom et son mode d’organisation.
Créée en 1984, le HPG – « Forces de défense du peuple » – d’abord appelé le HRK – « Forces de Libération du Kurdistan » -, est la branche armée du PKK. Abdullah Öcalan était à la tête du HPG jusqu’à son arrestation en 1999, auquel succéda Murat Karayilan en 2013.
L’arrestation en février 1999 du chef historique du PKK, Abdullah Öcalan et les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, qui ouvra une ère de « guerre contre le terrorisme », poussèrent le PKK à se restructurer.
En 2002, le PKK se renomma le KADEK – « Congrès du Kurdistan pour la Démocratie et la Liberté » –puis en 2003 le KONGRA GEL – « Congrès du Peuple du Kurdistan ».
En 2002 toujours est créé le PCDK – « Parti démocratique du Kurdistan » – branche politique irakienne du PKK. Avec à sa tête Diyar Garip et Necibe Ömer.
En 2003, le PKK fonde le PYD – « Parti de l’Union Démocratique » – organisation politique et branche syrienne du PKK avec comme co-président Shahoz Hesen et Ayshe Hiso. Comme pour le PKK, il possède une division armée, le YPG – « Unités de Protection Populaire ».
En 2004, le PKK crée le TAK – « les Faucons de la Liberté du Kurdistan » – une unité des forces spéciales chargée de mener les attentats les plus violents sur les civils dans l’ouest du pays. Par ce biais, l’organisation terroriste vise un double objectif, d’une part, de mener des campagnes de terrorisme contre les civils sans compromettre le nom du PKK dans l’opinion publique occidentale, et d’autre part, de se placer comme « modéré » face aux éléments fanatiques et incontrôlés du TAK.
En 2005, le PKK fonde le KKK – « Communauté de la Confédération du Kurdistan » – auquel succédera en 2007 le KCK – « Groupe des Communautés du Kurdistan » – structure destinée à chapeauter les différentes émanations du PKK, ce dernier étant désormais l’appellation pour les actions en Turquie.
Le KCK fonctionne selon un mode pyramidal, en haut de la pyramide se trouve Abdullah Öcalan considéré comme le guide suprême de l’organisation et qui prend les décisions en dernier ressort, le KCK se subdivise ensuite en 3 branches principales, elles-mêmes divisées en branches secondaires :
Législative, qui reprendra le nom de KONGRA GEL – « Congrès du Peuple du Kurdistan » – avec à sa tête un Kurde de Turquie, Zübeyir Aydar. Elle donne en principe la ligne directrice sur les questions sociales, politiques, idéologiques, financières, des femmes, populaires, de défense et relations publiques-organisation que doit suivre la branche exécutive.
Judicaire, chargée de défendre le « système démocratique et la liberté du peuple kurde », de juger au sein de « tribunaux populaires » les « traites et les capitulards », ainsi que les cas d’ « indiscipline » au sein de la branche armée. Elle est dirigée par un ancien procureur de la République islamique d’Iran, qui répond au nom de code « Kazi ».
Exécutive, codirigée par Cemil Bayik et Hülya Oran alias Bese Hozat, deux Kurdes originaire de Turquie, cette branche met en application les décisions prises par la branche législative et est responsable des actions armées.
En 2007, est créé le PJAK – « Parti de la vie libre du Kurdistan » – organisation politique et branche iranienne du KCK avec à sa tête Siamand Moini et Zîlan Vejîn. Comme pour le PKK, il possède une division armée le HRK – « Forces de Défense du Kurdistan Oriental ».
Ainsi, « il est important de noter que « le PCDK (Irak), PYD (Syrie) et le PJAK (Iran) ne sont pas des « filiales » ou des « groupes frères » du PKK, ils ne sont pas « liés » ou « proches » ou « dérivés » du PKK. Ils sont organiquement des composantes intégrées de la même organisation qui partage les mêmes membres, la même idéologie et la même structure de commandement sous l’autorité ultime d’Abdullah Öcalan et ses adjoints du PKK dont le siège se trouve dans les montagnes de Qandil au nord de l’Irak
Enfin, le PKK dispose d’un énorme réseau de propagande-recrutement en Europe, couvrant des maisons d’édition, des journaux comme Yeni Özgür Politika en Allemagne, des stations de radio et des chaînes de télévision par satellite, notamment Roj TV (au Royaume-Uni). Firat News Agency aux Pays-Bas. » (16)
Idéologie du PKK :
Les années 1960-1980 ont été pour la Turquie une période d’instabilité aussi bien sur le plan économique, politique que social.
La crise économique engendre de grandes vagues d’agitation sociale qui s’expriment de manière de plus en plus violente, les manifestations succèdent aux grèves et les assassinats politiques se multiplient.
A cette époque, les profonds clivages et les grandes tensions politiques issues de la lutte de deux blocs – capitaliste et communiste – pour l’hégémonie se prolongent en Turquie par la « guerre » des groupes radicaux d’extrême gauche et d’extrême droite faisant des victimes tous les jours dans les 2 camps.
A la fin des années 1960 la situation est chaotique, chômage, inflation, paralysie politique, terrorisme des groupes radicaux.
C’est dans ce climat d’instabilité, de conflits et d’impuissance politique que durant les années 1960-1980 l’armée intervient par 2 fois.
La première intervention a lieu le 12 mars 1971 par voie de mémorandum demandant de lutter contre la guerre fratricide, la crise économique et l’anarchie politique par la formation, dans le cadre des principes démocratiques, d’un gouvernement fort et crédible.
Des centaines de membres des groupes radicaux de droite et de gauche sont arrêtés et torturés ou fuient à l’étranger.
En octobre 1973, l’économie s’améliorant et avec l’arrêt du terrorisme, le gouvernement civil est entièrement réinstallé.
Une amnistie est décrétée libérant des centaines de militants politiques davantage radicalisés et ayant constitués des réseaux plus solides lors de leur détention en prison. Par ailleurs, l’amnistie a permis aux radicaux d’extrême gauche exilés en Europe de revenir en Turquie devenues plus dangereux avec l’expérience acquise auprès de leurs homologues européens.
C’est à cette période et ce contexte que le futur fondateur du PKK, Abdullah Öcalan, créé, après avoir passé 7 mois en prison, l’organisation « Kurdistan Révolutionnaire » qui fait avant tout la promotion du nationalisme kurde, du séparatisme et de l’irrédentisme.
Considéré avec méfiance par les différents groupes de gauche, en raison de son nationalisme ethnique, le groupe d’A. Öcalan, seul sur ce créneau, cristallisera rapidement les revendications identitaires kurdes.
En 1978, il créé le PKK – « Parti des Travailleurs du Kurdistan » dont l’idéologie combinait le marxisme-léninisme et le nationalisme kurde – qui se caractérisait par une volonté séparatiste, plus tard transformé en une demande d’autonomie.
Afin de monopoliser la parole politique kurde, A. Öcalan s’en prend très vite à ceux qu’il considère comme ses rivaux. Ainsi, il dénonce tous les autres représentants kurdes qui ne participent pas de sa guerre contre la Turquie comme « vendus » et « collabos », qui ne sont pas de « vrais révolutionnaires ». Il va jusqu’à charger le légendaire leader kurde Mollah Mustafa Barzani.
Il justifie son radicalisme par le manque de réussite des autres mouvements qu’il impute à leur pusillanimité révolutionnaire – il y a là une argumentation qui pousse nécessairement à la violence, car moins il y a de « réussites » plus il faut être radical, ce qui correspond à la pensée des groupes d’extrême gauche de l’époque.
Par ailleurs, l’idéologie marxiste-léniniste offrait deux arguments à A. Öcalan :
. Le séparatisme, le marxisme-léninisme sépare le monde en deux catégories, les « prolétaires- exploités » et les « capitalistes-exploiteurs ».
. La disparation de l’Etat, ce dernier étant considéré comme un instrument de domination d’une classe, l’avènement du socialisme qui dissout les classes amènerait nécessairement la disparation de l’Etat.
Même si la catégorie « prolétaire » et la catégorie « kurde » ne se coïncidait pas, et même si la « dictature du prolétariat » là où il avait cours apportait avec lui l’absolutisme étatique, cela donnait au PKK des arguments idéologiques dans sa guerre contre la Turquie.
Le coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980, dans un contexte de crise économique et d’affrontements armés entre les groupes radicaux, et la répression qui a suivi a donné au PKK des arguments supplémentaires permettant la recrue de militants de plus en plus nombreux.
Jusqu’en 1999, et l’arrestation d’Abdullah Öcalan au Kenya, le PKK s’est réclamé de l’idéologie marxiste-léniniste.
Le reniement par A. Öcalan de la « cause kurde » à la suite de son arrestation et les attentats du 11 septembre 2001, qui ouvraient une ère de « guerre contre le terrorisme » poussaient le PKK à se repositionner.
En 2001, le KADEK – « Congrès du Kurdistan pour la Démocratie et la Liberté » – remplace le PKK, puis au congrès de 2003 le KADEK devient le KONGRA GEL – « Congrès du Peuple du Kurdistan » – abandonnant ostensiblement l’idéologie marxiste-léniniste.
En détention, A. Öcalan se familiarise avec les théoriciens sociaux occidentaux, et en particulier avec le théoricien social américain Murray Bookchin d’où il emprunte les principes de mode de gouvernement communaliste qui vise à organiser les sociétés d’une manière décentralisée selon les lignes écologiques et démocratiques, A Öcalan adaptera cette forme de pensée politique sous le terme de « confédération démocratique ».
Murray Bookchin est un intellectuel passé par le marxisme-léninisme et ayant rejoint la mouvance anarchiste qui selon Bookchin aurait vocation à « libérer » les hommes dans tous leurs rapports alors que le marxisme-léninisme ne se focaliserait que sur les rapports de domination économique.
La pensée idéaliste de l’intellectuel américain se heurte néanmoins à des objections fondamentales.
D’une part, il n’est pas du tout assuré que la répression, la domination et le refoulement procèdent de la société sous sa forme d’organisation capitaliste ou autre, le plus souvent les hommes donnent les bâtons pour se faire battre, le malaise social n’est pas un « effet » de la civilisation, mais il est intrinsèque à celle-ci, comme dit Freud, le malaise est « dans » la civilisation, toute organisation politique qui évacue cette dimension subjective humaine est vouée à l’échec, aussi révolutionnaire qu’elle paraisse être.
D’autre part, placer le curseur de l’opposition entre démocratie représentative et démocratie directe au niveau de la volonté de domination d’un groupe sur un autre – riches/pauvres, exploitants/exploités etc. – n’est pas pertinent, toute vie en groupe suppose une organisation, qu’elle soit économique, politique, administrative etc. chacune de ses parties étant regroupée au sein d’institutions dont la gestion est assurée de manière individuelle ou collégiale qui représente la volonté et les intérêts du groupe duquel leur pouvoir est issu. Même les marxistes-léninistes et le « prolétariat au pouvoir » n’ont pas échappé à cette dichotomie, le « prolétariat au pouvoir » signifiant dès lors le parti ou un groupe d’hommes qui se recommande de la masse populaire.
Tout groupe conséquent et toute organisation complexe créent une coupure de plus en plus grande entre les représentants et les représentés sans qu’il y aille intrinsèquement d’une volonté de domination. Tout groupe, communauté, nation est nécessairement et à divers degrés – prononcé en France et moins en Grande-Bretagne, par exemple – centraliste dans son fonctionnement.
Néanmoins, ces contradictions internes du « communalisme » conceptualisé par Murray Bookchin et récupéré par A. Öcalan dans son « confédéralisme démocratique » n’intéressent pas ce dernier qui y trouve surtout des arguments au goût du jour, l’écologisme, le fédéralisme, et surtout sa guerre contre l’Etat qu’il a pu sauvegarder du marxisme-léninisme.
Or, il n’y a qu’à regarder l’action centralisateur du PYD en Syrie – branche syrienne du PKK – sous l’autorité et la prédominance kurde pour voir que le PYD censé représenter le « confédéralisme démocratique » n’échappe pas au centralisme, comme l’Union soviétique n’a pas échappé au centralisme non plus au nom du pouvoir du peuple.
En somme, la posture idéologique du PKK si elle prend appui sur des idéologies qui se réclament de la « classe des dominés » a pour objectif une place dans celui des dominants, son alliance, tout à fait contradictoire mais significative, avec les Etats-Unis en Syrie est à ce titre parlant (17).
La violence idéologique et la violence armée, que rien ne justifie (18), de cette organisation terroriste, prenant pour cible aussi bien les forces que les civils, s’inscrit dans ce cadre dans lequel il ne s’agit pas de viser une « égalité » ou d’obtenir des « droits » mais, mais usant d’une violence extrême, créer des clivages profonds dans la société afin d’alimenter un séparatisme qui se cristalliserait sur le PKK, permettant à ce dernier de grossir d’autant.
Le PKK se nourrit de violences et se développe autour de la violence, ce qui est néfaste pour la société – la société turque – dans laquelle elle agit et dans celle – les communautés kurdes – qu’elle organise. Un exemple, parmi de nombreux autres, lors de la bataille de Kobane – ville de Syrie – entre les djihadistes et le YPG – branche armée du PYD, c’est-à-dire le PKK en Syrie – le leader kurde Selahattin Demirtaş, président du parti HDP en Turquie, proche des conceptions du PKK, a appelé à un soulèvement en Turquie qui a fait des centaines de victimes civiles, parmi lesquels des adolescents, comme Yasin Börü, lynchés (19) par les partisans du PKK.
Chronologie de l’évolution du PKK :
Plusieurs événements seront importants dans l’évolution du PKK.
1971 – 1980, coups d’Etat militaires qui permettront au PKK, par réaction, de lui fournir un grand nombre de militants.
1980 – 1998, accueil du PKK par la Syrie, pour des raisons géopolitiques – le partage de l’eau – et politiques – le pro-occidentalisme de la Turquie –, qui permet à l’organisation terroriste d’avoir un terrain de repli et de développement.
1991, première guerre du Golfe, qui crée une zone d’exclusion militaire au nord de l’Irak qui profite au PKK où il trouve un terrain de développement économique et armé.
Février 1999, arrestation du chef historique du PKK, Abdullah Öcalan, au Kenya.
11 septembre 2001, attentats terroristes aux Etats-Unis qui ouvrent une ère de « guerre contre le terrorisme ».
2001 – 2003 réorganisation du PKK, abandonnant l’idéologie marxiste-léniniste pour le « confédéralisme démocratique. »
2003, seconde guerre du Golfe, qui crée un environnement chaotique en Irak dont profite le PKK.
2011, guerre civile en Syrie, les djihadistes, en partie armés par les puissances occidentales, attaquent l’Etat syrien. La participation du PKK syrien – c’est-à-dire le PYD – à la guerre contre le djihadisme, ayant servi à affaiblir la Syrie, lui donne une certaine légitimité internationale et lui fournit un prétexte de poids dans sa rhétorique de « lutte armée. »
La guerre en Syrie entre les djihadistes et le PKK est, avant d’être idéologique, celle du contrôle de territoires. Ainsi, les Kurdes syriens qui représentent entre 5 et 8.5% de la population syrienne contrôle, à l’aide de l’appui américain, près de 25% du territoire syrien dont la majeure partie des zones pétrolifères et des terres arables.
Actuellement, en Occident, l’image d’Epinal du PYD comme des « combattants de la liberté » est évidemment surjouée, d’une part elle est intéressée – installation des forces militaires occidentales au Moyen-Orient et contrôle des zones et des corridors pétrolifères – et d’autre part idéalisée, car il est assez difficile de n’être pas « meilleur » moralement que les djihadistes, à une époque où l’Occident a besoin, pour ses opinions publiques, de se sentir moralement meilleur.
Conclusion :
Le PKK est organisation criminelle hybride qui allie :
Idéologie, mélangeant ce qui lui donne le plus d’envergure et de dynamisme d’action, nationalisme et idéologie d’extrême gauche.
Communication, propagandes à travers les médias traditionnels et les réseaux sociaux.
Economie, financement par le crime organisé, principalement le trafic de drogue.
Terrorisme, en 40 ans de « lutte », le PKK a perpétré des dizaines de milliers d’actions terroristes – attaques à l’arme légère ou lourde, par mine, assassinats, attentats à la bombe, incendies volontaires sur des lieux publics, enlèvements – lors desquelles il a assassiné plus de 6 500 civils, 5 000 fonctionnaires d’Etat et soldats et fait plus de 20 000 blessés.
Le directeur de recherche en criminologie à l’Université Paris II, François Haut, définit le PKK comme une « organisation criminelle hybride ».
Ainsi, à côté des activités criminelles des organisations terroristes et jointe à elles, afin de les justifier et les légitimer, il y a une « identité symbolique. »
Concernant le PKK, cette « identité symbolique » est un assemblage d’une idéologie, d’abord marxiste-léniniste de « lutte des classes » puis celle de « confédéralisme démocratique », avec le nationalisme kurde.
Sans cette dimension identitaire et idéologique les groupes armés révolutionnaires seraient de « simples » organisations mafieuses. Or, ces deux postures – idéologie et identitaire – permettent au PKK de justifier ses activités criminelles, le terrorisme, la xénophobie et le fanatisme aux yeux de la communauté internationale.
Aujourd’hui, le PKK se développe principalement par sa branche syrienne le PYD, dont l’opposition au djihadisme lui a conféré une aura internationale. Or, pour faire un parallèle, si la Russie staliniste s’est battu contre l’Allemagne nazie, cela ne faisait pas de l’URSS une grande démocratie ou des « combattants de la liberté », les millions de victimes du stalinisme sont là pour le démontrer.
Ainsi, l’organisation terroriste PKK considère la Syrie comme un tremplin pour sa principale bataille contre la Turquie. L’attentat à la bombe du 16 février 2016 en plein cœur d’Ankara contre un bus militaire faisant 29 morts et 61 blessés, parmi lesquels des civils, a été revendiqué par le PKK, par l’intermédiaire de sa branche TAK. Néanmoins, les autorités turques ont très vite désigné le PYD – c’est-à-dire le PKK syrien – comme les organisateurs de cet attentat. Nombre de terroristes du PKK qui visent la Turquie sont aujourd’hui formés en Syrie.
Récemment, un des commandants du YPG – branche armée du PYD – Muhammed Reşşo, a été interpelé en Turquie dans la ville de Fethiye alors qu’il préparant des attentats. Il raconte comment, à la suite d’une formation en Syrie, dans les zones contrôlées par le PYD, les terroristes du PYD préparent des attentats en Turquie en s’infiltrant par la méditerranée (20).
Ce qui démontre que les opérations militaires de la Turquie en Syrie contre le PYD sont indispensables pour sa sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme.
La profusion de noms du PKK – PYD, PJAK, PCDK, KONGRA-GEL, KCK, avec les branches armées TAK, HPG, YPG, HRK etc – est destinée d’une part à sa communication envers les opinions publiques occidentales afin de séparer la qualification de terrorisme du PKK de ses branches, et d’autre part de de désaccoupler le PKK de ces branches afin qu’il puisse s’en débarrasser au besoin. Mais, il s’agit là fondamentalement d’une même et seule structure.
A ce titre, bien que les Etats-Unis soutiennent actuellement le PYD en Syrie, l’ancien secrétaire à la Défense – équivalent du ministre de la Défense en Europe – des Etats-Unis, Ashton Carter, a, lors d’une audience au Sénat américain, affirmé qu’il y avait des « liens substantiels » entre le PYD et le PKK (21).
Ainsi, que feront les personnes, politiques, associations, Etats en Occident qui soutiennent le PYD actuellement, lorsque cette organisation perpétrera des attentats terroristes en Turquie, dont ils seront en partie responsables par leur soutien ? La demande de droits est une chose, le terrorisme une autre et il faut voir et savoir tous les pans qui structurent le PKK pour se faire une idée réelle de ce mouvement.
(1) https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/101409%20pkk%20press%20chart.pdf
(2) Parmi les crimes du PKK visant les civils :
20 juin, 1987, Pinarcik : massacre de 30 civils dont 6 femmes et 16 enfants.
8 juillet 1987, Pençenek : 15 civils tués.
9 juillet 1987, Midyat : 31 dont 17 enfants tués.
18 août 1987, Kılıçkaya : 23 civils tués.
10 octobre 1987, Meşeiçi : 13 civils tués.
9 mai 1988, Nusaybin : 11 civils dont 8 enfants et 2 femmes tués.
8 août 1989, Yüksekova : les terroristes du PKK enlèvent 10 villageois, 5 sont tués.
9 août 1989, Beytüşebap : 11 civils sont enlevés par le PKK, 6 sont tuées.
10 août 1989, Hisar : 4 civils dont 2 enfants tués.
12 août 1989, Bahçesaray : 6 civils tués.
18 août 1989, Yüksekova : 9 civils sont enlevés par le PKK, 5 sont tués.
12 décembre 1989, Cevizlik : 6 civils tués.
1 mars 1990, Mamrastepe : 3 femmes sont exécutées, 7 civils enlevés dont 4 retrouvés morts.
22 mars 1990, Elazığ : 9 ingénieurs tués.
9 mai 1990, Van : 5 civils tués.
11 juin 1990, Sirnak : 27 civils tués, dont 7 femmes et 12 enfants.
14 juillet 1991, Kahramanmaraş : 9 civils tués.
25 décembre 1991, Istanbul : 11 civils tués dans l’incendie provoqué avec des cocktails Molotov lancés par des terroristes du PKK dans un centre commercial.
11 juin 1992, Bitlis : 13 civils sont exécutés.
5 septembre 1992, Bingöl : les terroristes du PKK arrêtent des voitures et exécutent 7 civils.
15 septembre 1992, Batman : 6 civils tués.
20 octobre 1992, Bingöl : les terroristes du PKK arrêtent un bus, font descendre les voyageurs et exécutent 19 civils.
10 novembre 1992, Diyarbakir : 9 civils tués.
15 novembre 1992, Iğdır : 8 civils tués.
5 juillet 1993, Başbağlar : 28 civils tués, 4 disparus, 58 maisons sont brûlées.
19 Juillet 1993, Van : 26 civils dont 22 femmes et enfants.
4 Août 1993, Bitlis : 28 civils sont regroupés et fusillés, 15 civils trouvent la mort.
10 août 1993, Bingöl : 8 civils tués.
29 août 1993, Elazığ : 14 civils sont enlevés, 9 sont tués.
4 octobre 1993, Madrin : 26 civils tués dans un autobus par l’explosion d’une mine posée par les terroristes du PKK.
25 octobre 1993, Yavi : plus d’une centaine de civils regroupés dans un café sont fusillés, 35 sont tués, et 50 blessés.
1 janvier 1995, Diyarbakır : 9 civils, 5 femmes et 4 enfants tués par le PKK.
25 mai 1995, Batman : 8 civils tués dans un attentat à la bombe.
24 juillet 1998, Van : 12 civils tués.
5 août 1995, Hatay : 8 civils tués dont 3 enfants tués lors d’une attaque par roquette.
7 septembre 1995, Hatay : 9 civils fusillés par le PKK.
13 août 1996, Sivas : 8 civils sont tués dans la gare de la ville.
15 décembre 1997, Mardin : 12 civils tués.
09 juillet 1998, Istanbul : attentat à la bombe, 7 civils tués et 111 blessés.
13 mars 1999, Istanbul : attentat à la bombe dans le marché bleu, 13 civils tués.
2000 – 2004 : le PKK ayant subi de lourdes pertes et avec l’arrestation de son chef Adbullah Öcalan décrète un cessé le feu.
30 avril 2005, Kusadasi : attentat à la bombe à dans la ville touristique, 5 civils tués et 20 blessés.
13 septembre 2006, Baglar : attentat à la bombe 17 civils dont 7 enfants tués.
29 septembre 2007, Sirnak : les terroristes du PKK mitraillent un bus 5 civils tués.
10 Mai 2008, Batman : 3 civils tués par l’explosion d’une mine.
27 juillet 2008, Istanbul : double attentat à la bombe qui fait 18 morts dont 5 enfants et 150 blessés.
10 Mai 2009, Sirnak : 5 civils tués.
31 juillet 2010, Batman : 4 civils tués par l’explosion d’une mine posée par le PKK.
16 septembre, 2010 : 9 civils dont 1 enfant tués.
30 octobre 2010, Istanbul : attentat suicide, 16 civils blessés.
11 septembre 2011, Hakkari : 3 civils tués lors d’un mariage.
21 septembre 2011, Siirt : 4 civils tués.
22 septembre 2011, Anakra : attentat à la bombe, 3 civils tués et 34 blessés.
26 septembre 2011, Batman : 2 civils tués.
18 octobre 2011, Bitlis : 5 civils tués.
29 octobre 2011, Bingöl : 3 civils tués par un attentat-suicide.
13 Mars 2016, Ankara : Attentat à la voiture piégé dans le parc public GüvenPark, 36 civils tués.
12 mai 2017, Diyarbakir : 16 civils tués dans un attentat à la bombe.
9 juin et 12 juillet 2017, à Batman et Siverek : 2 professeurs sont assassinés par le PKK.
(3) http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/3053-PYD-Foreign-Fighter-Project-1.pdf
(4) http://pkkningercekyuzu.com/pkknin-mavi-carsi-katliami-13-mart-1999/
(5) http://www.pkkeylemleri.com/darikent-katliami6-ogretmen-kursuna-dizildi/
(6) https://www.haberler.com/ocalan-ilk-kursunu-kurtlere-sikti-3384865-haberi/
(7) http://www.gazetevatan.com/pkk-nin-coklu-yapi-taktigi-865029-gundem/
(8) http://www.academia.edu/26593181/Financing_The_PKK_Terrorism_and_Drug_Trafficking_-_fulltext
(9) http://www.turquie-news.com/spip.php?article2495
(10) http://www.academia.edu/26593181/Financing_The_PKK_Terrorism_and_Drug_Trafficking_-_fulltext
(11) http://www.ensonhaber.com/pkknin-yillik-uyusturucu-geliri-15-milyar-dolar-2016-06-27.html
(12) https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg318.aspx
(13) https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg318.aspx
(14) http://www.academia.edu/26593181/Financing_The_PKK_Terrorism_and_Drug_Trafficking_-_fulltext
(15) http://www.spiegel.de/international/world/kurdish-propaganda-and-patriotism-how-the-pkk-operates-in-europe-a-565298.html
(16) http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/3053-PYD-Foreign-Fighter-Project-1.pdf
(17) Ainsi, depuis des décennies, les groupes radicaux de gauche en Turquie – DHKP-C, TKP-ML, DEV SOL, PKK etc. – ont attaqué la Turquie parce qu’elle était dans le camp américain, aujourd’hui ces mêmes groupes attaques la Turquie avec les Américains. Cet anti-impérialisme de façade est dû soit à une ignorance historique, politique, comme dans les cas du DHKP-C, TKP-ML, soit à une duplicité comme dans le cas du PKK.
(18) En Bulgarie, même s’il y a eu des progrès depuis son adhésion à l’Union européenne, les Bulgares d’origine turque sont des citoyens de seconde zone, ayant vécu des pressions aussi bien politiques que sociales, mais ces derniers n’ont jamais eu recourt à la violence armée, encore moins au terrorisme.
(19) Vidéo du lynchage de Yasin Börü par les partisans du PKK, dans la ville de Diyarbakir : https://www.youtube.com/watch?v=8SGSQjfevoM
(20) http://www.sonhaberler.com/genel/afrin-sorumlusu-denizden-sizacaktik-yakalandik-h592139.html
(21) https://www.youtube.com/watch?v=4GUdQJle-1s
İlker TEKİN

 Cessez-le-feu – Ceasefire – Ateşkes / Free-Palestine / Palestine libre / Özgür-Filistin.
Cessez-le-feu – Ceasefire – Ateşkes / Free-Palestine / Palestine libre / Özgür-Filistin. CFT 94 Valenton et son équipe ont organisé le traditionnel kermesse d’automne 2023
CFT 94 Valenton et son équipe ont organisé le traditionnel kermesse d’automne 2023 La Turquie et le monde turc célèbrent avec fierté le centenaire de la proclamation de la République de Turquie.
La Turquie et le monde turc célèbrent avec fierté le centenaire de la proclamation de la République de Turquie. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılını kutluyor / La République de Turquie célèbre son centenaire.
Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılını kutluyor / La République de Turquie célèbre son centenaire. Batı emperyalizminin hedefleri ve yeni yöntemleri / Les cibles et les nouvelles méthodes de l’impérialisme occidental.
Batı emperyalizminin hedefleri ve yeni yöntemleri / Les cibles et les nouvelles méthodes de l’impérialisme occidental.